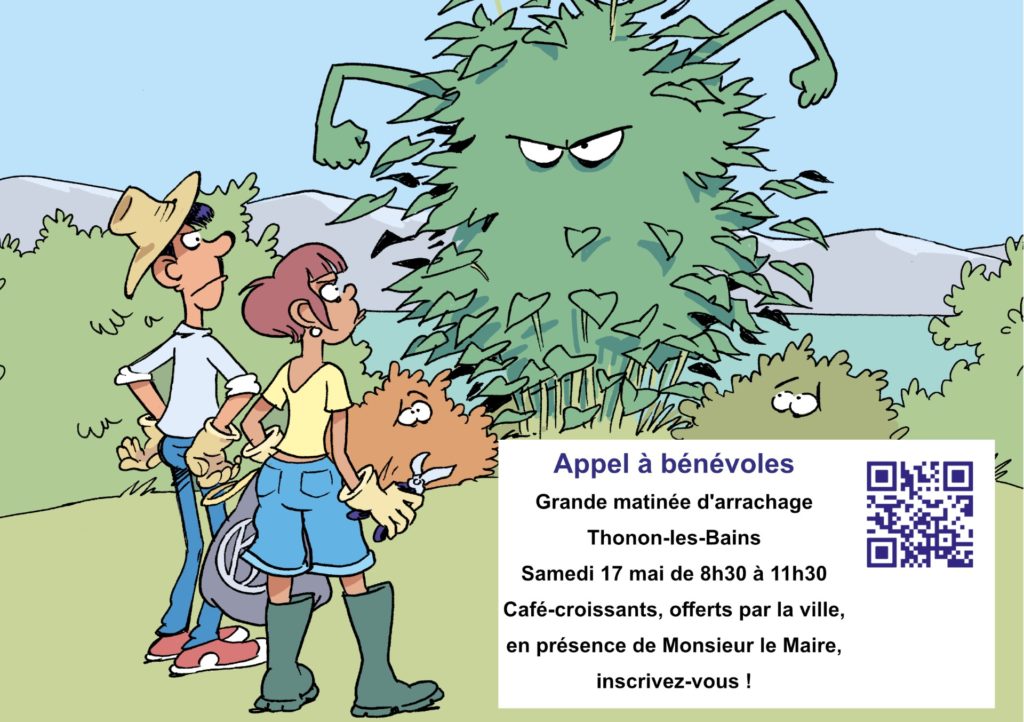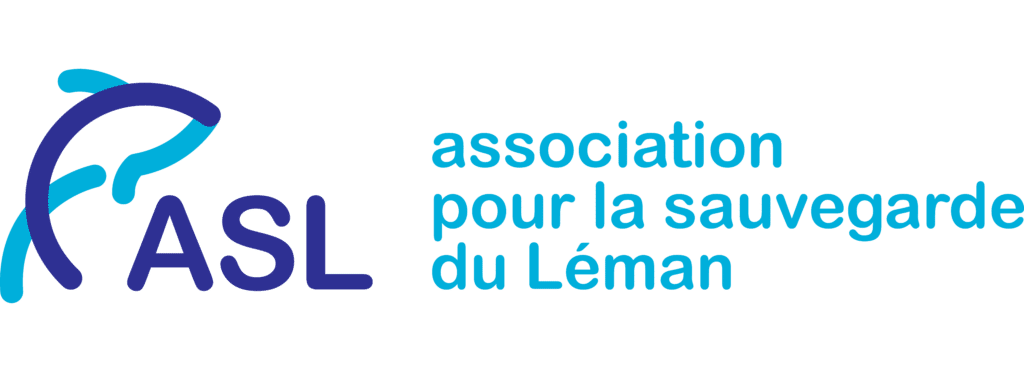La 6ème édition de « Couleurs du lac », un évènement organisé par l’ASL et la commune de Nernier avec le soutien du Géoparc du Chablais, s’est tenue le 29 septembre au château de Ripaille. Son titre, “Mémoire d’avenir du Léman” est une invitation faite à tous d’interroger ce qui, dans le passé du Léman, pourrait « inspirer » les actions d’aujourd’hui destinées à préparer ce grand lac à vivre demain.
Nous profitons tous quotidiennement de ce Léman si familier : il semble là pour toujours, éternel, bleu, transparent et d’une stabilité apaisante. Bienveillant, il nous offre des services somptueux et gratuits. Et puis un jour, en septembre 2021, les belles couleurs du lac tout d’un coup disparaissent : le plan d’eau, gorgé d’une algue microscopique, est presqu’entièrement coloré en brun. Une odeur nauséabonde se répand sur les plages. Nous n’osons plus nous baigner. Ceux, et ils sont nombreux, dont l’eau du robinet vient du lac se questionnent sur sa qualité sanitaire. Toute la presse en parle puis …c’est l’oubli, comme a été oublié le Léman verdâtre et glauque des années 70. Eté 2024, l’actualité rebondit : plusieurs plages du haut lac sont interdites après un intense épisode pluvieux ayant perturbé le bon fonctionnement de stations d’épuration. Peu de temps après, ce sont des algues toxiques qui polluent une petite zone littorale. Une idée s’impose alors : ces dégradations récentes de l’état du lac, bien que temporaires, ne seraient-elles pas des signes de faiblesse de l’écosystème ? d’ailleurs est-il si bien protégé ? demain serait-il en fait inquiétant ? Dans ces moments de doute, il est utile de questionner le passé et donc d’interroger les scientifiques qui analysent la mémoire du Léman avec un œil sur le futur. La 6ème édition de « Couleur du Lac » a accueilli deux conférenciers qui s’emploient à partager avec le public cette mémoire d’avenir.
Avec “le Léman : 800 000 ans d’histoire d’un grand lac”, Walter Wildi, professeur honoraire de géologie de l’environnement à l’Université de Genève, livre à l’auditoire une histoire du Léman écrite à partir des données de la géologie régionale. Car le Léman est tout autant un « objet géologique » que les montagnes qui l’entourent. Il s’est construit sur des pas de temps géologiques, en 800’000 ans, lors de grands épisodes de glaciation et de périodes interglaciaires. On trouve les premières traces d’un lac à Ecoteaux, près de Palézieux. Walter est un conteur captivant pour une exploration passionnante dans l’espace et le temps à travers au moins 4 glaciations et autant de périodes interglaciaires. Depuis 10 700 ans, pendant la période post-glaciaire, toute une valse de fluctuations climatiques (notamment de la température et de la pluviométrie) se manifestant du Néolithique et jusqu’il y a 3000 ans, par des périodes de baisse du niveau lacustre en dessous de l’exutoire du lac. Le Léman devient alors une « mer intérieure » qui n’alimente plus le Rhône à l’aval de Genève. Sur ses rives s’installent des habitats humains à l’origine des palafittes. Au-delà de ce cas extrême, le professeur Wildi nous montre que l’impact de la relation entre variations climatiques et niveaux du Léman sur les débits du Rhône, est une réalité bien établie.
Dans “Mémoire de carotte ” Jean-Philippe Jenny, chercheur à l’INRAE (Thonon-Chambéry), nous raconte comment l’étude de carottes sédimentaires permet de reconstituer la trajectoire de désoxygénation des couches d’eaux profondes du Léman. Il explique avec beaucoup de pédagogie la complexité des mécanismes en cause. Dans les années 1980-2000, la désoxygénation résulte de la combinaison entre l’eutrophisation* du plan d’eau, un phénomène local dû à l’intensification des activités humaines autour du lac, et le déficit de brassage complet de la masse d’eau conséquence lui d’une dynamique planétaire, le changement climatique. Calculs et modélisation à l’appui notre conférencier confirme que ce défaut d’oxygénation augmentera dans le futur proche sous l’effet de la pression climatique et ce malgré la bonne maîtrise de l’eutrophisation depuis 15 ans. La masse d’eau du fond du lac, privée de brassages oxygénateurs, sera de plus en plus isolée comme emprisonnée sous un couvercle, et deviendra une sorte de « fermenteur » dont la vie biologique se limite à des micro-organismes et qui laisse échapper des bouffées de polluants.
Alors que faire ? Il est certain que des actions ambitieuses visant à réduire notre empreinte locale sur le climat seraient utiles mais sans effet direct sur l’état du lac. Faut-il pour autant baisser les bras ? non car on peut envisager de renforcer la résistance du lac face au stress dû au changement climatique, notamment en agissant sur le territoire qui alimente le lac en eau pour réduire encore davantage les charges polluantes de celle-ci. Attention ! ce territoire dénommé « bassin versant » et qui va globalement des crêtes au littoral, est à la fois vaste (7900km² du glacier du Rhône à Genève) et diversifié (montagnes, forêts, villes, villages, champs, cultures…). Pourtant, agir et mobiliser les acteurs à cette échelle est possible : le « retour d’expérience sur l’Opération Rivières Propres » de l’ASL présenté par Jean-Marcel Dorioz et Olivier Goy, le prouve. En bref, tout commence il y a 40 ans quand la CIPEL démontre que l’essentiel de la pollution du lac par les phosphates, principale cause de l’eutrophisation évoquée précédemment, provient surtout des effluents d’eaux usées domestiques rejetés insuffisamment ou non traités, un peu partout dans le réseau hydrographique du Léman. S’emparant de ce problème, l’ASL prend l’initiative osée de lancer un inventaire participatif exhaustif de ces rejets sauvages qui polluent le Léman. C’est l’« Opération Rivières Propres », nom de code ORP, qui se déploie progressivement sur les trois-quarts du réseau hydrographique lémanique (soit sur plus de 8000km de cours d’eau). Près de 3000 bénévoles se mobilisent pendant une décennie pour parcourir ce réseau. Chacun, individuellement ou en groupe, prend en charge un tronçon de rivière ou de ruisseau, réalise un repérage cartographique, relève l’état des berges et de l’environnement, note les déchets, localise et surtout identifie les rejets d’eau d’égout non raccordés. La mise en évidence du caractère polluant des rejets repérés s’appuie sur les résultats fournis par un kit d’analyses chimiques simples et sur une fiche d’observation multi-indicateurs. Cet élan massif d’observations rigoureuses de terrain est mis au service d’un territoire qui découvre alors l’ampleur des atteintes à son environnement aquatique, y compris là où on ne les attendait pas. Les résultats** sont communiqués aux élus locaux et cantonaux afin qu’ils remédient aux situations polluantes et illégales constatées et mettent en place des systèmes de collecte et traitement des eaux usées performants (c’est-à-dire incluant la dé-phosphatation). La sauvegarde du Léman devient ainsi l’affaire de tous.
Et maintenant ? La sauvegarde du Léman, qui est plus que jamais l’affaire de tous, s’inscrit dans un tout autre contexte. Certes, il existe encore des tuyaux pollueurs récalcitrants, des fuites accidentelles, des accumulations de déchets …tout un ensemble d’atteintes récurrentes à la qualité des eaux dont il faut renforcer la maîtrise. Mais les grands enjeux du Léman et les pressions associées à ceux-ci sont ailleurs. L’écosystème lac est en première ligne : « reconfiguré » par le changement des températures, il tend à réagir différemment aux pressions.
La nature, l’origine et la distribution spatiale des pressions exercées sur le lac ont, elles aussi, évolué : les pressions se sont démultipliées, diversifiées, délocalisées et dispersées. La pollution des eaux fournit une bonne image des transformations en cours : la charge polluante compte désormais, outre les polluants « classiques » tels que métaux lourds et PCB, des « émergents » dont les micro-plastiques et les innombrables perturbateurs endocriniens qui impactent sournoisement l’écosystème par des actions de groupe, en « cocktail » de micro-doses. Autre transformation critique, une grande part des polluants provient d’un peu partout dans le bassin versant et est mobilisée de façon diffuse lors des pluies. La maîtrise de la pollution hydrique s’en trouve complexifiée, d’autant que les causes ultimes de celle-ci, comme de la plupart des autres pressions, s’enracinent souvent hors et loin du territoire lémanique, voire au niveau planétaire ! Dans un tel contexte, tout peut sembler perdu d’avance. Or, il nous reste une marge de manœuvre locale, un levier possible d’action compensatrice : améliorer encore la qualité des eaux alimentant le lac et celle des milieux aquatiques associés à celui-ci. La relation état du lac – état du territoire est donc, comme du temps d’ORP, cruciale pour la santé actuelle et à venir du Léman.
Des élus sont attentifs à ces questions. En témoigne, la présence de Madame Anne Cécile Violland, députée, et de Monsieur Christophe Songeon, vice-président de Thonon-Agglo, à ce sixième “Couleurs du lac”, sans compter le soutien sans faille depuis 6 ans de Madame Marie Pierre Berthier, vice-présidente du SIAC en charge du Géoparc. Bien entendu, aucun progrès ne serait possible sans vous tous qui partagez, relayez et soutenez notre ambition de conserver durablement la bonne santé du Léman.
Paul ROUX et Jean-Marcel DORIOZ (comité de l’ASL)
—
Nos remerciements vont :
- aux deux conférenciers invités, W. Wildi et JP Jenny
- à la Fondation Ripaille pour son accueil
- à la ville de Thonon pour ses encouragements
- à la ville d’EVIAN, à la CGN et la Maison de la Rivière (Vaud) de leur aide
Nota bene :
* L’eutrophisation résulte d’une sur-alimentation de l’écosystème en phosphates qui provoque une surproduction de matières organiques polluant le lac.
** ORP
Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
Nombre de cours d’eau : 315
Longueur totale de cours d’eau : 8’300 km soit 16’600 km de rives !
Ainsi, en 12 ans, près de 3’000 bénévoles (familles, classes, scouts, etc,) et civilistes, étudiants parcourent 12’000 km à pied et débusquent :
20’143 tuyaux dont :
6’077 sont polluants ou suspects de l’être, dont
- 2’254 sont incontestablement polluants
- 1’390 sont très probablement polluants
- 2’433 sont probablement polluants, à confirmer
- 7’421 dépôts de déchets
L’ASL publie 985 dossiers de résultats détaillés adressés aux 493 communes du bassin lémanique, ainsi qu’aux administrations cantonales, départementales et fédérales concernées